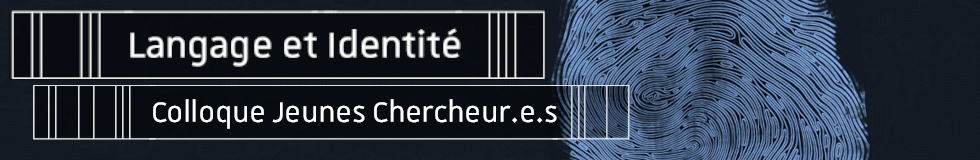
À propos
COLLOQUE JEUNES CHERCHEUR·EUSE·S (CJC)
4e édition : 12—13 juin 2025
Université de Strasbourg
« Langage et Identité »
« Le concept d’identité est difficile à définir. »
Charaudeau & Maingueneau (2002, p. 299)
La notion d’identité est couramment mobilisée que ce soit dans le discours scientifique des sciences humaines et sociales (SHS) (cf. Baudry & Juchs, 2007) ou dans le discours ordinaire, pour évoquer des problématiques comme : identité et conformité au groupe, identité personnelle, professionnelle, sociale, régionale, crise ou perte d’identité, revendications identitaires... Vu les appropriations disciplinaires et conceptuelles nombreuses de cette notion, il importe de la contextualiser.
Adoptant un regard critique, Berque (1983) montre qu’il y a toujours eu un va-et-vient contradictoire, voire conflictuel, entre l’identité collective et l’identité individuelle, si bien qu’on peut se demander si l’identité est un entre-deux. Cette vision va dans le sens d’un constructivisme social, où l’identité est un processus ancré dans les pratiques sociales. De Fina, Schiffrin & Bamberg (2006, pp. 1-23) rappellent deux points importants. D’une part, les recherches dans divers domaines des SHS ont démontré le rôle fondamental des processus linguistiques dans la création et la négociation des identités. D’autre part, l’une des tendances dominantes dans les études sur l’identité est l’antiessentialisme : l’individu peut « montrer », « jouer » plusieurs identités à la fois selon les pratiques et les relations sociales. Pris dans cette complexité relationnelle, le moi de l’individu est imprégné d’un nous, et ses productions langagières reflètent ce jeu. Le traitement de l’expression langagière de l’identité nécessite de recourir à d’autres notions, comme celles de sujet et d’altérité (Charaudeau, 2023, p. 106), situant l’identité dans l’échange, dans l’interaction, comme facteur de mêmeté, d’identification, de différenciation, et, à fortiori, de catégorisation (cf. e.g. Trudgill, 2000, p. 13 ou De Fina, Schiffrin & Bamberg, 2006, pp. 2-3).
Ce colloque s’inscrit dans une tradition entamée en 2012 au sein du laboratoire LiLPa – Linguistique, Langues, Parole à l’Université de Strasbourg. Organisée par des jeunes chercheur·euse·s issu·e·s des sciences du langage (SDL), cette quatrième édition veut mettre en pratique une épistémologie contributive (Paveau, 2012, p. 55), une interdisciplinarité focalisée (Charaudeau 2023, p. 19), et favoriser un partage de savoirs autour de la thématique « Langage et identité ».
L’objectif est de mener une réflexion autour de l’unicité, de la multiplicité et/ou de la complexité des identités, de leur dimension figée et/ou mouvante, dans l’expression langagière. Quelles visions de l’identité peuvent coexister dans les SDL ? Entre texte, image, son, quelles données utiliser pour y accéder ? et quelles méthodes : corpus existants, logiciels de webscraping, travail de terrain, intelligence artificielle ? Comment penser l’identité en termes de variations ? Quelle place occupe l’identité du ou de la chercheur·euse ? Y a-t-il une identité disciplinaire ?
Voilà autant de questions d’ordre épistémologique ou méthodologique problématisées dans les quatre axes suivants :
-
Identité et langues
-
Identité et discours
-
Identité et voix
-
Identité et posture du ou de la chercheur·euse
AXE 1 — Identité et langues
La langue peut être instrumentalisée lorsqu’elle sert à construire l’identité d’une communauté autour d’elle (Blanchet, 2022, p. 13 ; Launey, 2022, p. 37), par une attribution catégorielle menant à un double mouvement d’assimilation et de différenciation (Camilleri et al., 2002). Ce processus peut concerner tout type de groupe : social, national, régional, religieux, etc. Comment est-ce que cette instrumentalisation des langues par le corps social pour définir des identités nationales ou régionales peut être étudiée ? Dans un contexte où la pratique des langues régionales régresse/stagne, le lien entre la connaissance d’une langue dite « régionale » et le statut de cette dernière en tant que marqueur d’identité (personnelle, patrimoniale, locale, etc.) (Huck, 2022 ; Sperandio, 2017) se trouve-t-il modifié ? Dans le cadre d’une didactique et d’une sociolinguistique « des situations linguistiques hétérogènes » (Le Page & Tabouret-Keller, 1985), qu’en est-il des liens entre les sujets-apprenant·e·s, les formateur·ice·s et leurs identités (professionnelles, plurilingues, etc.) ? Qu’en est-il des rapports entre langues, identifications et plurilinguisme en devenir ? Quel impact une éducation bi-/plurilingue a-t-elle sur la relation des élèves à la connaissance des langues et sur leurs identités ?
AXE 2 — Identité et discours
Le concept d’identité peut également être mis en lien avec les discours en langue générale ou spécialisée (Blasco, 2022), les discours ordinaires, les discours pathologiques (Amblard et al., 2021 ; Cortal et al., 2023, Lévesque et al., 2018), ou encore les discours institutionnels ou militants (Huck, 2005). L’identité se manifeste dans le discours de chacun·e au quotidien, ce qui la rattache au concept même de « soi ». Ainsi, chaque type de discours porte en lui des marques qui l’identifient par rapport à son contexte de production et son ou sa locuteur·rice/scripteur·rice. Par exemple, le cas des pronoms personnels je, tu et il (Kleiber & Vassiliadou, 2012) ou on (Delaborde & Landragin, 2019) a été considéré en ce sens. Dans ce contexte, plusieurs questions peuvent être soulevées : Quelles informations le discours nous donne-t-il sur l’identité de celui ou celle qui l’énonce ? comment passer par le discours pour étudier les rapports complexes qui existent entre la langue générale et les langues de spécialité (discours médical, institutionnel, militant) ? Comment est-ce que les pathologies (lésions cérébrales, dépression, schizophrénie, etc.) influent sur les identités des locuteur·rice·s ? Comment étudier ces influences dans et à travers les productions discursives des locuteur·ice·s ? Et qu’en est-il lorsque l’acte discursif n’appartient plus uniquement à un être humain, mais à un algorithme qui génère du texte dans un langage qui semble produit par un humain (Zhang et al., 2024) ?
AXE 3 — Identité et voix
Le lien entre la voix et l’identité semble évident dans la mesure où l’âge, le genre, l’origine sont autant d’informations qu’on peut inférer de la voix (Révis, 2013). Quel lien faire par exemple entre identité de genre et voix ? Comment les stéréotypes de genre modifient-ils les perceptions auditives en fonction de l'identité de genre attribuée aux locuteur·rice·s (Arnold & Candea, 2015) ? D’un autre côté, certaines études mobilisent le concept d’identité sonore, qui comprend entre autres, les voix utilisées pour faire reconnaître une entreprise auprès d’un public (cf. Carron, 2016). Peut-on dire que les caractéristiques physiques d’une voix lui donnent une identité ? Comment cela s’applique-t-il à la voix synthétisée ? On parle également d’identité artistique pour laquelle la voix joue un rôle central au sein des performances poétiques orales (rap, slam, spoken word…) (Béthune 2004 ; Migliore & Obin 2018 ; Somers 2005 ; Vorger 2016). Comment les choix de techniques vocales et verbales spécifiques influencent-ils la perception de l'identité de l'artiste par le public ? Enfin, comment aborder les cas d’imitation prosodique ou de parodie ? Somme toute, il s’agit dans cet axe d’analyser la manière dont la voix sert de vecteur d'identité dans différentes formes d'expression.
AXE 4 — Identité et posture du ou de la chercheur·euse
Face au manque de visibilité des sciences du langage auprès d’un grand public, pointé par Charaudeau (2006), apparaissent des initiatives pour affirmer l’identité de cette discipline, comme celle du tract des Linguistes atterré·e·s (2023). En affirmant l’identité de sa discipline, le ou la chercheur·euse affirme-t-il·elle sa propre identité ? Si le ou la chercheur·euse « s’utilise comme instrument de recherche et comme filtre » (Mucchielli, 2009, p. 77), comment son identité imprègne-t-elle sa recherche et sa discipline ? Si on postule que son identité est constituée « de catégories qui lui sont propres, de savoirs antérieurs, d’une socialisation particulière, mais aussi d’un inconscient » (Canut, et al., 2018, p. 14), comment ces éléments identitaires influencent-ils sa posture par rapport à son objet d’étude ? Et quand le ou la chercheur·euse travaille avec des locuteur·rice·s, comment leurs identités multiples, construites et perçues, se rencontrent-elles ? Les interactions à différents niveaux entre ces éléments obligent-elles à parler de postures multiples ? Quel sens donner à la notion de posture et comment conceptualiser les interrelations entre identité(s) et posture(s) ? Comment celles-ci s’influencent et se nourrissent-elles ?
***
À travers le prisme des sciences du langage (SDL), ce colloque ouvre un espace de discussion aux mastérant·e·s, doctorant·e·s et aux jeunes docteur·e·s. Nous encourageons des propositions de communication qui s’inscrivent dans un ou plusieurs axes du colloque. Les langues pour les propositions de communication, les présentations orales, les supports de présentation qui seront projetés et les posters sont le français et l’anglais.
Les propositions de communication orale (20 minutes + 10 minutes de discussion) ou de communication affichée (poster) doivent être déposées pour le 15 janvier 2025 à 23h55 (UTC+1), via la plateforme Sciencesconf. Elles consisteront en un fichier anonymisé comprenant un titre, un résumé d’1 page maximum (format A4, Times New Roman taille 12, interligne 1,5cm), un maximum de cinq mots-clés et une bibliographie. Les informations concernant les auteurs sont à encoder directement dans la plateforme de soumission (cf. onglet « Nouveau dépôt ») lorsque vous y déposerez votre fichier. Les propositions de contribution seront évaluées par notre comité scientifique. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse cjcsdl@sciencesconf.org.
1https://cjcsdl.sciencesconf.org/
Bibliographie
Amblard, M., Rebuschi, M., & Musiol, M. (2021). Corpus et pathologie mentale : particularités dans la constitution et l’analyse d’une ressource. Presses Universitaires de Nancy. https://inria.hal.science/hal-02269622.
Arnold, A., & Candea, M. (2015). Comment étudier l’influence des stéréotypes de genre et de race sur la perception de la parole ? Langage & société, 152(2), 75-96.
Baudry, R., & Juchs J.-P. (2007). Définir l’identité. Hypothèses, 10(1), 155-167. https://doi.org/10.3917/hyp.061.0155.
Berque, J. (1983). Identité. Dans L. Sfez (dir.), Dictionnaire critique de la communication. Presses Universitaires de France.
Béthune, C. (2004). Pour une esthétique du rap. Klincksieck.
Blanchet, P. (2022). Éléments de contextualisation pour une analyse de la loi Molac : glottophobie institutionnelle et combat pour les droits linguistiques en France. Cahiers internationaux de sociolinguistique. Langues minorées: des décisions de justice et de leurs effets. L’exemple de la loi Molac (France 2021) et de ses suites, 20(1), 13‑28. https://doi.org/10.3917/cisl.2201.0013.
Blasco, M. (2022). Parler à l’hôpital : écouter ce qui est dit, décrypter ce qui se dit. Nodus Publikationen.
Camilleri, C., Kastersztein, J., Lipiansky, E.-M., Malewska-Peyre, H., Taboada-Leonetti, I., & Vasquez, A. (2002). Stratégies identitaires. Presses Universitaires de France.
Canut, C., Danos, F., Him-Aquilli, M. & Panis, C. (2018). Le langage, une pratique sociale : Éléments d’une sociolinguistique politique. Presses universitaires de Franche-Comté.
Carron, M. (2016). Méthodes et Outils pour Définir et Véhiculer une Identité Sonore : Application au design sonore identitaire de la marque SNCF. Thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie. https://hal.science/tel-01321199.
Charaudeau, P., & Maingueneau, D., dir. (2002). Dictionnaire d’analyse du discours. Seuil.
Charaudeau, P. (2006). Discipline Sciences du langage. Texte envoyé au bureau de l’ALES et de l’ASL. http://www.patrick-charaudeau.com/Discipline-Sciences-du-langage.html.
Charaudeau, P. (2009). Identité sociale et identité discursive. Un jeu de miroir fondateur de l’activité langagière. Dans P. Charaudeau (dir.), Identités sociales et discursives du sujet parlant. L’Harmattan.
Charaudeau, P. (2023). Le sujet parlant en sciences du langage. Contraintes et libertés. Une perspective interdisciplinaire. Lambert-Lucas. Limoges.
Cortal, G., Finkel, A., Paroubek, P., & Ye, L. (2023). Emotion Recognition based on Psychological Components in Guided Narratives for Emotion Regulation. Association for Computational Linguistics, 77-81. https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.10446.
De Fina, A., & Schiffrin, D. (Éds.). (2006). Discourse and Identity (Repr). Cambridge Univ. Press.
Delaborde, M., & Landragin, F. (2019). En quoi le pronom «on» a-t-il une valeur anaphorique?: Le cas des successions d’occurrences de «on». Cahiers de praxématique, 72. https://doi.org/10.4000/praxematique.5464
Huck, D. (2005). Minoration et majoration dans le discours épilinguistique institutionnel sur les langues en Alsace. Étude diachronique exploratoire. Cahiers de sociolinguistique, 10(1), 187‑202. https://doi.org/10.3917/csl.0501.0187.
Huck, D. (2022). Les parlers dialectaux en Alsace. https://hal.science/hal-03662138.
Kleiber, G., & Vassiliadou, H. (2012). Histoire(s) de personnes: Qui est je? Qui est tu? Qui est il? Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 31, Article 31. https://doi.org/10.4000/cps.2216
Launey, M. (2022). La République et les langues. Éditions Raisons d’agir.
Le Page, R. B. & Tabouret-Keller, A. ([1985] 2006), Acts of Identity. Creole-based Approaches to Language and Ethnicity, Paris, E.M.E.
Les Linguistes atterré·e·s. (2023). Le français va très bien, merci. Tract 49. Gallimard. https://www.tract-linguistes.org/
Lévesque, M., Negura, L., Moreau, N., & Laflamme-Lagoke, M. (2018). L’influence de l’identité linguistique et de l’âge sur la représentation sociale des services de santé mentale chez les personnes dites dépressives. Minorités linguistiques et société, 9, 118-42. https://doi.org/10.7202/1043499ar.
Migliore, O., & Obin, N. (2018). At the Interface of Speech and Music: A Study of Prosody and Musical Prosody in Rap Music. Proceedings of Speech Prosody, Poznam, Pologne [en ligne]. 2018-113. http://dx.doi.org/10.21437/SpeechProsody.2018-113
Mucchielli, A. (Éd.) (2009). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines (3e éd.). Armand Colin.
Paveau, M.-A. (2012). Ce que disent les objets. Sens, affordance, cognition. Synergies Pays Riverains de la Baltique, 2012, 9, pp.53-65.
Révis, J. (2013). La voix et soi : Ce que notre voix dit de nous. De Boeck-Solal.
Somers, S.B.A. (2005). The Cultural Politics of Slam Poetry. Race, Identity, and the Performance of Popular Verse in America. University of Michigan Press.
Sperandio, C. (2017). Représentations des langues, accents et régionalismes d’Alsace. Étude empirique et sociolinguistique. Cahiers du plurilinguisme européen, 9. https://doi.org/10.57086/cpe.986.
Trudgill, P. (2000). Sociolinguistics: an introduction to language and society (4th ed). Penguin.
Vorger, C. (2016). Slam, une poétique : de Grand Corps Malade à Boutchou. Belles Lettres.
Zhang, Q., Gao, C., Chen, D., Huang, Y., Huang, Y., Sun, Z., Zhang, S., Li, W., Fu, Z., Wan, Y. & Sun, L. (2024). LLM-as-a-Coauthor: Can Mixed Human-Written and Machine-Generated Text Be Detected?. In Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024 (pp. 409-436).

